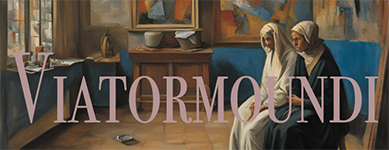1963 JANVIER-FÉVRIER No 1
NOUVELLE SÉRIE 1 CINQUANTIÈME ANNÉE
MUSÉE NEUCHATELOIS
ORGANE DE LA SOCIETE D'HISTOIRE DU CANTON DE NEUCHATEL
FONDE EN 1864

SOMMAIRE
1. Lettres inédites de Madame de Charrière, publiées par Charly Guyot, avec planche
2. Avant les événements de 1848: l'affaire des clubs communistes et de la Jeune Allemagne, par Marc Reinhardt
3. Bibliographie, par Léon Montandon
4. Chronique, par Eric Berthoud, Claire Rosselet et Jacques Petitpierre
ON S'ABONNE A L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL
Prix de l'abonnement: Suisse, Fr. 15.-; étranger, Fr. 17.50. Pour les membres de la Société d'histoire: Suisse, Fr. 12.50; étranger, Fr. 15.-. Compte de chèques "Musée neuchâtelois" IV 1622. Parait six fois par an.
page 65
L'une des bases matérielles du mariage était, nous l'avons vu 1, les biens plus ou moins considérables apportés par l'un ou l'autre des conjoints ou garantis par sa famille, son tuteur ou ses amis. Ce capital initial était le plus souvent une somme d'argent, mais il pouvait être complété par des immeubles, maisons, champs, prés, vignes, dont il est difficile d'évaluer l'importance parce que la surface de ces biens n'est pas indiquée malgré le soin et la précision avec lesquels ils sont toujours délimités 2.
La fiancée apportait en outre son trousseau ou, du moins, la promesse de fournir un trousseau. Certes, si le jeune homme venait habiter chez les parents de sa femme le trousseau était moins indispensable et certains contrats prévoient de ne le livrer qu'après plusieurs années, au moment où les jeunes époux fonderaient un foyer indépendant. Lorsque Hansoz, le fils de messire Othemand, épousa la fille de Steiner, cosandier 3, en 1425, il fut convenu, par exemple, qu'il demeurerait quatre ans avec la famille de son beau-père et qu'au bout de cette période seulement celui-ci donnerait un trousseau à sa fille 4.Perreson, fille de feu Estévenant de la Jaluse, au Locle, apportait à son mari, à part sa dot de soixante-dix écus d'or, " son trosel comme fille de prudome
5 ".
Girarde, fille de Jeannerod, de SaInt-Blaise, recevait de son père " son trosel et vestuez comme fille de bourgeois, es bon hus et costumes de Nuefchastel ". En outre, elle apportait une robe à la grand-mère de l'époux 6.Jean Bisard donnait à sa fille Henriette sa " roube noceaule " lorsqu'elle épousa Jean, fils de Vauthier de Colombier
7.Les vêtements apportés n'étaient pas très nombreux à cette époque, puisque l'une des filles les plus richement dotées, la nièce de Jaques de Fère, chanoine de Neuchâtel et curé de Morteau, n'apporta que deux robes de couleur et deux jupons, malgré sa dot de 200 florins d'or. Son oncle, est-il dit, " la vestiraz de deux robes de coleurs, de deux gaudichon, honnestement 8 ". Etait-ce la coutume ? Jehannete, fille de Richard Bouehellier, dont la dot était de 80 florins, reçut deux robes aussi.
" La vestiraz ledit Richard ", dit l'acte, " de deux robes de coleurs honestes et souffisantes, son trosseaul selon son estat 9 ".Vu le silence des traités de mariage sur la composition du trousseau, il nous faut demander à d'autres documents non pas l'état d'un trousseau mais celui d'un ménage. Les testaments énumèrent, par bonheur pour nous, avec grand soin, les legs souvent fort divers et très précis que fait le testateur. Les immeubles viennent toujours d'abord: vignes, prés, champs, jardins, " cernils ". Mais c'est l'énumération des meubles qui nous permet parfois de reconstituer tout un ménage, celui de Henri Hugue, de Hauterive, par exemple, qui légua tous ses biens à sa femme en 1462
10,
Après les terres il énumère le bétail: " bœufs, vaiches, chenesses, velz, chevaul, porcelz ".
La batterie et les meubles de cuisine y font suite, se composant de " pot, paelle de metaul, pot d'estain, plates escuelles, gieles d'estain et de boys, pelles frutieuses, comacles, arches, seles, casses et archetes.".
Le pot était une marmite ou un récipient en métal, fer, cuivre ou étain, dont la contenance est parfois indiquée en pots, une mesure équivalent à 1,90425 litre 11. Ces pots de métal étaient souvent de très lourdes marmites. L'un d'eux, en 1452, pesait 37 livres et fut payé à raison de 3 sols faibles la livre, sans compter cinq livres de métal fourni 12.On distinguait du pot de métal ou d'étain la chaudière, appelée alors "choudière" ou "chadière", et la poêle, nommée "paelle" ou "pele", qui toutes deux étaient faites de fer ou de cuivre. La poêle pouvait être pendante ou non, c'est-à-dire être suspendue à une crémaillère ou posée sur un trépied, si elle n'était elle-même pourvue de pieds 13. La " pele de bassin" était une grande louche utilisée pour puiser de l'eau 14.
Les " gieles d'estain et de boy" dont il est question dans ce texte n'étaient sans doute pas des " gerles ", telles que nous ,les connaissons encore, ces cuviers évases au bas et mesurant un hectolitre, ou autrefois 52 pots, c'étaient de simples baquets ovales ou coniques. Ceux d'étain étaient sans doute de dimensions très modestes, car ce métal était cher.
Les " comacles" étaient des crémaillères 15. Elles étaient indispensables à l'époque où toute la cuisine se faisait sur le foyer, car elles permettaient d'utiliser la chaleur des combustibles à grandes flammes, tandis que les casseroles à trépied et les poêles à frire de même type se posaient sur la braise.
Les arches et les archettes que cite notre texte étaIent simplement des coffres, grands et petits, dans lesquels on serrait le linge ou les provisions. On les plaçait toujours en lieu sûr, à l'abri du feu si possible, et
les bourgeois habitant hors de ville réservaient souvent une place pour déposer une ou plusieurs arches lorsqu'ils louaient à des tiers la demeure qu'ils possédaient à l'intérieur des murs.
Après la batterie de cuisine le testament d'Henri Hugue énumère les meubles, les objets garnissant la chambre à coucher tout d'abord, puis ceux qui confèrent un certain confort à la vie diurne: " lit, linceulx, cossins, oroillers, couverte de lit, et challier, mantis, targiennes, tables, chadeliers de fert, de loton et de boys, anaz, bichelet, voyre, excouveur, crulIion "
Les " linceux " dont il est question étaient des draps de lit. Ils nous livrent la preuve qu'on se couchait déjà bel et bien entre ses draps, dans un lit garni d'oreillers, de coussins et de couvertures. Les .draps étaient d'ailleurs d'autant plus indispensables que l'on ne connaissait ni chemise de nuit, ni pyjama. Dans un trousseau les draps étaient en nombre variable. Estévenin Guyau, d'Hauterive, en possédait au moins dix, selon les legs qu'elle charge son héritier d'exécuter 16. Un bourgeois du Landeron en distribue quarante-deux avec quatre lits garnis, dans son testament, en 1474 17. Le curé de Cressier en hérita vingt de son père, Pierre Blomyse, maréchal, bourgeois de Neuchatel, en 1479 18.Le lit se composait d'un châlit, le " challier " de notre énumération, c'est-à-dire d'un bois de lit, d'un matelas, de draps, de couvertures, appelées couvertes, d'une courtepointe, dite alors la " cutre " ou la " cutre pointe " et d'oreillers garnis de plumes 19. Il était souvent entouré de rideaux, les courtines ou " cultines " 20, suspendus à un ciel de lit 21. Avec quatre draps et une courtepointe, un lit valait 4 florins d'or, en 1451 22. En 1463, cinq lits garnis de couvertures, de coussins et de courtepointes valaient 3 florins chacun, 15 florins en tout 23. Lors du don d'un lit garni, le nombre des draps variait selon l'aisance du donateur ou sa générosité. Trois, et souvent six draps accompagnent un tel cadeau. Un lit complet que deux frères se partagèrent vers le milieu du siècle comptait 16 draps et valait 3 florins pour le reste 24, Selon un inventaire fait à sa mort, en 1453, le curé du Locle, Jean Furore, possédait six draps, trois coussins, trois courtepointes et une couverture de peau pour garnir son lit 25. Dans le Saugeais, pays qui touche la frontière de notre comté, les coutumes rédigées au milieu du XVe siècle, contiennent le passage suivant concernant le lit:
Que fille mariée à us de gaigneur, si en traitant ledit mariage est esté devisée qu'elle aura troussel et vêture, a été gardé d'ancienneté en la terre et seigneurie de Montbenoît, que si, à cause dudit troussel l'on a promis lit garni,
ladite fille aura et emportera lit et coussin de plume ensemble la couverture et de huit linceux et de deux rangs de tuailles 26, et s'il a été devisé qu'elle ne doit avoir lit plain, elle aura un coussin de plumes garni de courtepointes et quatre linceux sans lit et ung rang de tuailles contenant trois aunes, mesure de ladite terre 27.
Le lit avait une valeur relative plus grande qu'aujourd'hui, si bien que les hôpitaux avaient quelque peine à s'en procurer. Ils devaient surtout compter sur la générosité privée. C'est pourquoi dans les testaments les donations de lits sont assez fréquentes, destinées à l'hôpital du Saint-Esprit, à Neuchâtel, à l'hôpital de Fribourg ou même à l'hospice du Grand-Saint-Bernard 28.Lorsqu'un débiteur ne pouvait payer comptant il arrivait aussi qu'il dût mettre son lit en gage
29. En outre, le seigneur et ses officiers n'hésitaient pas à s'emparer du lit aussi bien que des autres meubles de ceux qui ne payaient pas à terme un cens ou une amende; toutefois ils avaient la sagesse ou la bonté de leur en laisser l'usage, comme le prouve entre autres, le texte suivant:
Jaquet Bellin et M., sa femme, de l'auctorité dudit Jaquet son mary present, congnoissent et confessent tenir de noble homme Jehan du Terrault, mayeur de Neuschastel, pour les deniers de mon très redoubté seigneur, c'est as savoir ung lit, ung grand cussin avec deux petiz, ensemble de quatre linceulx, et tous ses aultres biens meubles, pour en joyr soubz la main dudit Jehan du Terrault tant qu'il plaira audit Terrault, et ce pour le pris de six livres ou ce que se trouvera par bon compte (1482) 30.Dans la chambre de ménage ou à la cuisine, les bourgeois et les villageois de toutes conditions vivaient autour d'une table recouverte d'une " mantis ", c'est-à-dire d'une nappe, de " targiennes "
31, nos serviettes probablement, et garnie le soir de " chadeliers ", mot dont l'orthographe prouve qu'à Neuchâtel la nasale tombait parfois comme dans la chanson de la Sagne : " L'on voit passer l'triagle de ta a ta, les cha sont pleins de neige, c'est le printa. "
Pour boire, nos ancêtres disposaient de " bichelets ", nos gobelets, ou de hanaps lors des grandes occasions. Dans le texte cité plus haut on les appelle des " anaz ". Ils avaient également des verres bien que le verre fût alors assez rare et peu utilisé comme verre à vitres, les fenêtres étant parfois garnies de papier huilé. Les verres à boire avaient une valeur que nous ne soupçonnons guère aujourd'hui et nous sommes surpris de. trouver, par exemple, des tasses en verre mentionnées parmi la vaisselle
que le comte Jean de Fribourg dut mettre en gage pour obtenir un' emprunt en 1450 32.
Le vin et l'eau étaient servis dans des cruchons, appelés " crullions " ou " cruions ".
Est-ce dû à un hasard qu'à l'énumération des meubles et des ustensiles fasse suite celle des poules et des poussins, les " gelines " et " pussins"? Faut-il en inférer que ces oiseaux de basse-cour vivaient également à la cuisine? Nous sommes tentés de croire qu'ils n'en étaient guère éloignés, en nous rappelant certaines peintures hollandaises à peine postérieures. .
Afin que rien ne soit oublié, cette énumération d'objets composant le ménage d'un habitant d'Hauterive se clot par les termes suivants: " Et tous aultres varnement d'ostel, comme foin, paille de saitraz, comme tous aultres biens meubles appartenant. et competant a ung ostel ycy non specifiés, mesmement auxi, croc a terre, croc a femier, fossieux, piche, et pui, etc. " Ces objets sont faciles à identifier. Le " croc " est une houe, c'est-à-dire une pioche à deux ou trois dents. Le " fossieux ", actuellement un " fossoir ", est une grande pioche à deux dents utilisée pour labourer les vignes. La " piche " est un pic. Quant au " pui ", que nous avons trouvé ailleurs sous la forme de " puit ", c'était vraisemblablement l'instrument servant à " puer " " poer ", ou " pouer " la vigne, c'est-à-dire à la tailler au printemps 33.
Les objets de cuivre, de laiton et d'étain sont les seuls objets de luxe de cette famille hauterivienne. L'absence de bijoux d'or et d'argent ne nous surprend guère cependant, vu la rareté et le prix de ces métaux. Toutefois ils ne faisaient pas toujours défaut. Amyet du Chastel, boucher à la Neuveville, qui fait son testament à Neuchâtel où il habitait probablement en 1476, donne à sa fille " ung gobelet de boz cerdez d'argent "
qu'elle pourra choisir parmi six gobelets qu'il possède 34. Anthoinne, fille de Henri Pigaud, reçut pour son mariage la moitié des biens de son père, sauf quelques réserves. En particulier, de six coupes d'argent qu'il possédait, Henri n'en donna que deux à sa fille 35.
On conservait précieusement dans la famille qui avait la chance de les posséder les objets d'une telle valeur, ou parfois, par piété, on les léguait à l'Eglise. Clauda, fille de Jean Paris, veuve de Hencheman Gueyrard, de Champion, puis de Jean de la Grange, bourgeois de Neuchâtel, et remariée en troisièmes noces à Pierre Gaudet, bourgeois et conseiller de la ville, lègue dans son testament, en 1481, " quatre taxes d'argent " à part sa " vaissalle d'estain ", dont elle mentionne " quatre
escuelles plates, deux plats et un pot " 36. En 1449, Perretone, fille de feu Lobiot, de Cortébert, veuve de feu le Malx Girard, bourgeois de Neuchâtel, donne à l'église de la ville trois tasses d'argent 37.
Les objets d'argent étaient si précieux à cette époque que dans un acte d'arbitrage qui suivit la mort de Jehan Trout, en 1456, c'est en premier lieu que figurent " deux tasses d'argent " 38. Mais, d'une façon plus précise, que valaient ces objets? Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pierre Gaudet racheta une tasse d'argent pour dix livres et dix sols, en 1483. Il en fit faire une autre par Anthoine " le douryé ", auquel il donna la matière, soit deux onces d'argent, et qu'il rétribua de dix sols 39. Ces tasses n'étaient pas particulièrement lourdes puisqu'elles pesaient deux onces, c'est-à-dire à peu près 60 grammes, le poids de douze pièces actuelles d'un franc. Or, avec leur prix de dix livres, on pouvait acheter deux vaches. Une équivalence de 1450 nous apprend qu'un marc d'argent valait alors 9 francs 40. Or, le marc avait 8 onces et pesait à Paris 244,75 grammes et le franc valait une livre et demie de Lausanne, monnaie faible. Neuf francs valaient donc 13 1/2 livres. Il en aurait fallu 15 pour acheter trois vaches. Ce rapport est donc un peu moins favorable que le précédent. L'argent avait un tel pouvoir d'achat que juifs ou chrétiens n'hésitaient pas à prêter de grosses sommes sur la garantie de quelques coupes d'argent, de quelques gobelets ou de quelques tasses. Les comtes de Neuchâtel et les sires de Valangin furent parfois contraints d'engager leur vaisselle d"argent pour se procurer rapidement une somme indispensable 41, et les bourgeois faisaient de même quand ils le pouvaient. Ils empruntent, mais se gardent de vendre, ne perdant jamais l’espoir de rentrer un jour en possession du trésor qu'ils ont mis en gage ou " prêté ". Jean Emer, de Travers, par exemple, promet à Jean Rosselet, de Fontaines, qu'il lui rendra quatre livres de Lausanne, monnaie faible, si Rosselet lui rend un hanap d'argent qu'il lui a prêté (1463) 42.Les assiettes et les plats d'étain n'étaient nullement les plus communs. Les gens mangeaient généralement dans des assiettes de bois. Pierre, fils de Junod Joly, de Travers, en achète 25 à Richard Bouhellier, de Cernay, bourgeois de Neuchâtel, un commerçant souvent cité dans la seconde moitié du XVe siècle
43. Le fils de Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchâtel, lui-même, mangea ses premières bouillies dans des écuelles de bois que fournissait Estevenin Boivin, alias la Bolle, tourneur à Boudry, en 1454 44. Jean Furore, curé du Locle, possédait douze assiettes et plats de bois, et six assiettes et deux plats d'étain, selon l'inventaire dressé à sa mort en 1453 45.
L'épouse apportait son trousseau et le serrait dans une arche, c'est-à-dire dans un bahut, et conservait les objets les plus précieux dans une cassette ou un coffret. Une femme possédait parfois plusieurs de ces coffres pour y ranger tous ses biens, ceux qu'elle apportait et ceux dont son mari lui faisait présent. Dans les plus beaux de ces bahuts, un compartiment particulier était réservé aux bijoux, car les femmes ne manquaient pas de coquetterie. Le contrat de mariage omet rarement de stipuler que le mari devra " enjoyeler " sa femme, comme il convient à fille de bourgeois ou de prud'homme. " Enjoyeler ", c'est-à-dire parer de joyaux et de bijoux. Parmi les bijoux celui qui fut le plus recherché était une ceinture garnie de clous d'argent, comme celles que portent les saintes élégantes qui, derrière leur grille, garnissent encore le portail central de la collégiale de Berne. Ces ceintures, au prix de l'argent, coûtaient une fortune au mari. Pierre Besancenet du Locle, par exemple, dut y consacrer la valeur d'un bœuf entier, lorsqu'il épousa la fille de Richard Bouhellier en 1466. Voici sa promesse à ce propos:
En promectant je ledit Pierre, par mon serrement que dessus, ladite Jehannete, ma femme advenir ycelle Jehannete enjohyelés d'une corroie d'argent honneste, a la valeur de six florins d'or et d'autres johyaulx nupciaulx (1466) 46.
Si par malheur l'un des clous de la ceinture se détachait on le recueillait soigneusement. Claud a Paris, dans son testament (1481) n'oublie pas de léguer sa " petite corroie d'argent avec trois cloz d'argent que sont cheiu de la dite corroye " 47.Ces ceintures n'étaient pas toujours des courroies, c'est-à-dire faites de cuir. Elles étaient parfois de tissu. Jaquette, marchande à Grandson, avait deux ceintures de tissu de soie de trois doigts de large dont l'une était garnie de " blonque de mordant " et de dix-neuf clous, tandis que l'autre l'était d'une " bloncque de mordant a une chesnete " et de quatorze clous. Clous, " bloncque ", et chaînette étaient d'argent doré. Ensemble ces ceintures valaient 20 florins d'or en 1432 et avaient été déposées temporairement chez Roulin Roussel, de Couvet
48.Le bijou le plus apprécié après la courroie à clous d'argent fut certainement le chapelet de corail rouge, cette matière étant très rare encore et très recherchée. Ces chapelets de corail étaient fabriqués par Bourquin Favez " maistre a faire patrenostre " 49.
Ces bijoux étaient-ils offerts comme morgengabe? Nous le présumons, car parfois on les appelle des " mondres " et la valeur en est fixée avec précision. Pierre Musard, en épousant Bendicte, fille de Bendict
Schaffer, apporta à sa femme " pour les mondres " une courroie valant dix livres et un paternoster de soixante sols 50.Il fallait être riche pour posséder des bijoux en or. La comtesse de Neuchâtel en avait, c'est évident, certains nobles en possédaient aussi, telle Jeannette, fille d'Anthoine Renevier, donzel, femme de Nicolas de Grandson 51, en 1401, mais nous n'avons trouvé aucune mention de bijoux d'or dans les mains bourgeoises ou roturières.
Il va de soi que les objets d'argent étaient évalués au poids et non d'après leur valeur artistique lorsqu'on les remettait en gage pour couvrir un emprunt. Les seigneurs de Valangin recoururent souvent à ce procédé. Comme chaque pièce engagée est mentionnée soigneusement avec son poids nous pouvons nous faire une idée des bijoux de cette maison et de leur valeur relative. Le 21 avril 1422, Guillaume d'Arberg, seigneur de Valangin, désirant emprunter immédiatement une somme importante envoya à Fribourg son serviteur Jean le Billie, bourgeois de Valangin. Pour obtenir 180 livres fortes de Lausanne il dut remettre à son prêteur Jean Bergier, fils de Jean le Tavernier, bourgeois de Fribourg, les gages suivants appartenant à son maître:
six coupes d'argent munies chacune d'un pied d'argent doré du poids total de 9 marcs,
deux coupes d'argent du poids de 14 onces,
huit autres coupes d'argent, mais non d'argent fin, du poids de 5 marcs,
une ceinture ferrée d'argent avec 16 morlans représentant chacun une feuille de chêne. L'ardillon de la boucle manque, est-il précisé, et la ceinture pèse 7 marcs.
un " rolam de matzero munitam seu ferratam argenti deauratam " pesant 2 marcs,
un affiquet d'or muni d'une pierre et de perles du poids d'une once 52.
Le seigneur de Valangin mettait en gage un peu moins de 24 marcs d'argent. Au prix de 9 francs le marc cela représentait une valeur de 216 francs c'est-à-dire autant de livres fortes. En lui prêtant 180 livres on lui prêtait une somme quelque peu inférieure à la valeur du gage.
Jaqueline Lozeron, dans un article sur la vie au château de Valangin, nous parle d'autres emprunts garantis par- les coupes, les ceintures et les fermaux de la dame de Valangin négociés soit à Fribourg, soit à Genève dans l'officine des Médicis, en 1456 53.
Certes. nous ne trouvons pas chez nos bourgeois de Neuchâtel de très grandes richesses en orfèvrerie au XVe siècle. Leurs traces, s'il y en
avait, nous ont échappé 54. Il semble qu'ailleurs, en Suisse romande, il y ait eu des trésors plus considérables, à Vevey par exemple, où Pierre Torneir, un simple bourgeois, possédait des coupes, des gobelets, et même des aiguières d'argent qu'auraient enviés nos ancêtres. Voici l'état des objets qu'il parvint à envoyer à Fribourg pour y couvrir un emprunt en 1412:
une aiguière d'argent munie de six gobelets du même métal pesant 6 marcs et 6 onces,
six gobelets d'argent pesant 3 marcs et une once et quart,
deux gobelets d'argent doré pesant 2 marcs, 51/2 onces, et 1/8 d'once,
quatorze coupes d'argent du poids de 101/2 marcs et 1/8 d'once,
deux aiguières d'argent doré de 6 marcs et 11/2 once,
huit coupes d'argent doré pesant 10 marcs et 1 once.
Les témoins de cet emprunt sont un aubergiste et un orfèvre 55.
Il y avait à Fribourg différents orfèvres, Claude Doreir (1412),
Rodolphe Prüning (1430), Gllinchard (1441) 56; il y avait également un orfèvre à Yverdon, Antoine Pictet, auquel Girard Penthecostes, chapelain de Neuchâtel, acheta en 1455 quelques objets qu'il eut de la peine à payer, et auquel Vincent de Bariscourt, chanoine de Neuchâtel, redevait 4 livres et 14 sols la même année. Comme il ne payait pas, l'officiaI de la curie de Lausanne lui envoya un ordre de le faire jusqu'à la Saint-Gall 57. Mais il n'est pas certain qu'il y ait eu au milieu du siècle un orfèvre à Neuchâtel. Henri Favre, un bourgeois de la ville à qui Jean, seigneur de Colombier, chevalier, devait 35 florins de 15 sols .lausannois pour une courroie d'argent et un gobelet l'était peut-être 58. Quant à Jacques le Furbissioux qui, à côté d'autres denrées, vendait des bijoux, il est peu probable qu'il les fabriquait lui-même. Le fourbisseur avait alors un métier très précis, celui d'aiguiseur. C'est Jacques qui vendit un chapelet de corail à Conrad Cordier pour sa femme en 1454 59. Cependant, dès 1484, il y eut un orfèvre à Neuchâtel, maître André le dorier, alias André de la Rutte, ou André Rutenzwig, qui avait épousé Guillama Tropt, fille de Louis Tropt et veuve du notaire Pierre Bergier, un personnage très riche qui possédait en tout cas 200 florins du Rhin 60.
La beauté, la couleur et le prix des vêtements contribuaient aussi naturellement qu'aujourd'hui à la parure des femmes. Les bruns et les gris dominaient, mais il y avait également des, rouges, des verts, des violets, des pers. Les nombreux retables français ou allemands, ou les miniatures nous permettent de nous représenter sans grand risque d'erreur Agnellet Rosselet, par exemple, vêtue de son " chapiron de
brunete ", de son " manthiaul de brunete " et de sa " robe grisse ". Nous voyons aussi Catherine, la fille de maître Blanchard, de Fribourg, portant la veste verte qu'elle légua plus tard à l'hôpital de la Glorieuse vierge Marie, de Neuchâtel, pour en faire un ornement d'autel ou une chasuble. Elle portait aussi parfois une veste rouge dont elle fit présent à l'hôpital de la Vierge, à Fribourg, dans un but semblable, en 1463 61.
Parfois robes et manteaux étaient garnis ou doublés de fourrure d'agneau blanc ou d'écureil. Catherine, la femme du notaire Pierre Gruyère avait une robe de " voirs ", cette fourrure blanche et grise qui connut un tel succès au Moyen Age. Des clous d'argent rehaussaient l'éclat du tissu. Catherine fit don d'une telle étoffe à sa petite fille 62. La robe de " pers " n'était pas moins appréciée 63.
La variété des couvre-chefs était aussi grande que de nos jours, bien que la mode changeât plus lentement et qu'une femme pût sans ironie léguer ses chapeaux à la fille de sa fille 64.
Les tissus pour fabriquer robes ou bonnets venaient le plus souvent de Fribourg. Il fallait, en 1463, deux aunes de drap pour confectionner une jaquette et trois aunes pour faire un " gaudichon ", c'est-à-dire une jupe. La variété des étoffes était très grande, les qualités étant encore plus nombreuses que les couleurs 65. Leur solidité était stupéfiante. Marguerite Vauthier, par exemple, pouvait léguer à sa mort le drap de sa robe de vair à la chapelle Saint-Antoine, de Neuchâtel, pour en faire une chasuble, tandis qu'elle en léguait la fourrure à ses filles 66.
Les hommes n'étaient pas vêtus de couleurs moins vives que les femmes. Comme elles, ils portaient le chaperon rouge, pers, gris ou brun, la robe de drap gris ou brun, la plus commune, celle de drap de couleur, plus élégante, ou celle de vair 67. Mais à la place de la jupe de drap gris ils revêtaient une paire de chausses grises, vertes ou rouges 68. Ces chausses collantes n'étaient pas soutenues par des bretelles ou par une ceinture mais par des cordons qu'on nouait au pourpoint. De nombreux tableaux nous montrent d'une façon très claire ce qu'étaient les chausses: de très longs bas en drap qui habillaient le pied, la jambe et la cuisse et s'attachaient au vêtement supérieur par des cordons que l'on distingue facilement sur les personnages qui pour une raison ou une autre se sont débarrassés de leur jaque ou de leur robe 69. Le pourpoint était souvent appelé le " gipon ", terme qu'il convient de ne pas confondre avec le jupon qui, dans notre contrée portait le nom de gaudichon 70. Sur le pourpoint les hommes portaient une jaque ou une jaquette, appelée parfois un " displois " et si c'était nécessaire un manteau ou une houppelande 71.
Chaussés de souliers assez légers, pointus et sans bride, ils ne manquaient pas d'élégance. Le volet d'un retable conservé au Musée national, à Zurich, représentant un atelier de cordonnier, celui de saint Crépin, nous permet de nous représenter des chaussures quelque peu postérieures.
Les " escoffiers " fabriquaient les chaussures. Ils tenaient boutique dans l'actuelle Grand-Rue appelée alors la rue des escoffiers. D'autres artisans, les " cosandiers ", confectionnaient les vêtements.
Les prix variaient naturellement d'après la qualité de l'étoffe. En 1405, à Fribourg, la tunique que le maître tisserand donnait à son apprenti comme salaire valait 6 sols et la paire de chausses 4 sols. En 1409, dans la même ville, une paire de chausses est estimée 5 sols et le chaperon 4 sols 72.
Comme de nos jours, l'habillement ne comportait pas seulement des vêtements de dessus mais des sous-vêtements. Chacun, en effet, portait une chemise comme le prouvent de nombreux textes et de nombreux tableaux de l'époque. Ces derniers ne sont pas de chez nous, il est vrai, mais au XVe siècle le costume était très semblable en Allemagne, en Flandre, en Bourgogne, en France et même en Italie. Ainsi le costume du bourreau dans le tableau de Roger van der Weyden représentant la décollation de saint Jean-Baptiste nous montre que la chemise de l'époque se différenciait de la nôtre par sa large encolure et l'absence de col. Les manches étaient longues mais se portaient parfois retroussées. A la place du caleçon, les hommes portaient des braies courtes et ajustées appelées au XVe siècle les petits draps ou les menus draps 73.
Les vêtements des jeunes gens engagés comme serviteurs pendant une année ou deux nous sont connus par de nombreux contrats. A part leur salaire, ils recevaient en général une robe de " sargy " , c'est-à-dire de serge de laine, un pourpoint de triège, une toile assez grossière, une paire de chausses de serge, deux chemises, un chapeau et autant de souliers qu'il leur en fallait raisonnablement. Le nombre en est rarement indiqué et, quand il l'est, il varie de un à six 74. En revanche le prix, indice de la qualité des vêtements, est parfois mentionné, il ne dépasse pas un demi-florin pour toute la garde-robe et le chapeau seul vaut
souvent plus de la moitié de cette somme 75. Il arrive que le jeune serviteur ne reçoive pas les vêtements mais l'étoffe pour les faire: trois aunes de toile pour la robe et trois pour les chausses, en général 76.
Si les épais registres des notaires du XVe siècle renferment de nombreux contrats conclus avec des serviteurs, qu'ils soient ouvriers,
employés ou domestiques, il est évident cependant que, relativement à l'ensemble de la population, ce nombre est très faible. On peut en inférer que la plupart des ménages vivaient sans aide étrangère. Dans les familles qui engagent un serviteur il est souvent difficile de distinguer s'il s'agit d'un domestique, d'un ouvrier ou d'un manœuvre. Voici quelques exemples de ces contrats: .
En 1467, Petit Jean Vaigne, de Morteau, " afferme ", c'est-à-dire loue, son fils Perrin à Jean Perrin des Geneveys-sur-Coffrane, pour une année. Jean Perrin lui donnera deux florins d'or et ses vêtements 77.
En 1463, Nicolet Cruillot, fils de Jean, s'engage à servir Jaquenod Paris, bourgeois de Neuchâtel, pour un an. Il recevra 4 livres et demie et ses vêtements 78.
Guillaume Vaigne, fils de Jean, de Morteau, s'engage chez Jaquet Enchelic, bourgeois de Neuchâtel, en 1465, pour une année. Son salaire sera de 5 florins d'or sans compter ses vêtements 79.
Perrin Goynot, de Dampbelin, se loue à Michel Trinques pour 3 francs, monnaie de Bourgogne, et une paire de souliers, en 1473 80.
Nichod Budez, bourgeois de Neuchâtel, servira Perrod Pigaud, également bourgeois de Neuchâtel, pour 7 florins de 15 sols lausannois et ses vêtements dont la valeur ne dépassera pas un demi-florin, en 1413 81.
Jean Gatollière, de Montagny, entre en service chez Perronet Berquz, bourgeois de Neuchâtel, en 1410, pour 5 florins par an 82.
En 1411, Renaud Guieriod; d'Agnin (Asnens), servira Guiot Brillot,
de Missie (Missy), près de Payerne, pour 5 florins valant 14 sols faibles le florin, une paire de chausses de 6 sols au maximum, Une hache et une tarière 83; c'est-à-dire un gros perçoir de plusieurs mètres servant à percer les tuyaux de fontaines. Il se réserve quinze jours de congé la première année à l'époque des moissons.
Perrod Moguet, de " Choulet " (Chules ou GaIs) exige, lui, un muid de bon vin pour servir Jaquet Fermequet pendant un an, en 1425 84.
Tous ces contrats ont été faits pour une année, sauf un qui l'a été pour deux ans. Ceux qui s'engageaient comme serviteurs étaient soit de très jeunes gens que leurs parents louaient temporairement pour en avoir quelque profit, soit des bourgeois dont nous ne savons rien, soit des gens endettés s'engageant chez un créancier pour rembourser une dette. Perrin Raisière, par exemple, qui devait 13 florins à Rolate, femme de Jaquet le Pic, s'engagea à la servir pendant douze ans, en 1422 85. Dans le cas particulier Jaquet le Pic et Rolate, sa femme, ne semblent pas
avoir abusé de la situation puisqu'ils donnent à leur nouveau serviteur un salaire de sept florins et demi (de 16 sols lausannois) par an alors que l'usage était de n'en donner que cinq. Ce Perrin Raisière, bourgeois de Neuchâtel, était sans doute déjà libéré de ses obligations en 1428, puisqu'à cette date il s'engagea pour trois ans auprès de Rolet Crochet, de Cormondrèche, pour 24 florins d'or (à 15 sols le florin) c'est-à-dire pour 8 florins par an, sans compter les vêtements 86. Au terme de cet engagement, il passa chez Jacques Corbe, de Cormondrèche, qui lui promit 6 florins d'or par an, ses vêtements et un chapeau ayant la valeur de 10 sols 87.
Un serviteur spécialisé, un ouvrier connaissant un métier, avait un salaire beaucoup plus élevé qu'un simple domestique. Menod Fancillon, bourgeois de Neuchâtel, par exemple, fut engagé une année chez maître Octheniot, résidant à Saint-Aubin, pour le servir dans son métier. Il recevait 15 florins de 15 sols lausannois payables par trimestre sans compter ses frais et ses outils. Nous ignorons malheureusement quel métier permettait de rétribuer si largement un ouvrier 88. Un maçon gagnait 5 florins et demi par an auxquels s'ajoutaient trois paires de souliers, qu'il fût bourgeois de Neuchâtel, comme Perrod Marchand, ou étranger, comme Jean Bechorel de Morteau 89.
Les nobles donnaient à leurs serviteurs le même salaire que les bourgeois. Vauthier de Colombier, donzel, habitant Cormondrèche, promettait 5 florins par an à Girard Orriot, du même village, en 1471, et il lui donna 4 florins et 12 sols faibles, sans compter les vêtements, pour le salaire de la période allant du 14 décembre 1471 à la Saint-Gall de. l'année suivante 90.
En 1431, le chevalier Jean de Colombier donnait déjà 5 florins à son serviteur. Il avait engagé à cette date Aymonet Pochon et son fils Pierre en leur promettant 10 florins et à chacun d'eux, trois aunes de serge pour la tunique, autant pour les chausses, 15 sols pour le chapeau et les chaussures dont ils auraient besoin 91.
Un des points qui ne laisse pas de nous étonner, c'est que dans presque chaque contrat entre serviteur et maître, le serviteur est contraint d'énumérer quelques garants qui se chargeront de payer les frais éventuels causés par un service nuisible, ou tout simplement par une rupture de contrat. Aymon Pochon et son fils Pierre, que nous venons de citer, prièrent Estevenin Bertho, frère d'Aymon, et Nicholet Geniez, de promettre de servir à leur place Jean de Colombier, s'ils faisaient défaut, ou d'embaucher à leurs frais un serviteur qui le fît.
Les garanties que le maître estime indispensables vont très loin. Dans le contrat que passèrent Perrod Moguet, de Chules, et Jaquet Fermequet, bourgeois de la ville, en 1424, il est stipulé:
Et ou caus qui il aurait deffaut de le servir comme dist est de ma puissance, ledit Jaquet, etc., me pouroit demander en toute plaice et en toute cour tout les domaige qui l'en pouroit venir a deffaut de service comme dessus est dit 92.
Si un père met son fils en place c'est évidemment lui qui assume la responsabilité de la rupture éventuelle du contrat. Nous lisons:
Par tel que ou cas que ledit Perrin (le fils) ne faroit son terme pour quelconque cause ou excusation que ce soit, en celuy cas ledit Petit Jehan Vaigne (le père) s'enjoing de le faire ce que seraz affaire ou de rabbatre ce qu'il aroit deffallit a la equilpollance du pris que dessus (1467) 93.
Et moy ledit Jehan (le père) promet de refaire tout ce que ledit Guilleme mon filz ferait de faute (1465) 94.
Parfois même le serviteur doit engager tous ses biens pour le cas où il ne respecterait pas le contrat:
et causa quod non serviret, obligat bon a sua (1413) 95.
Il est évident que la garantie était plus sérieuse encore si le payement du salaire était anticipé. Anselme Séchaud, bourgeois de Neuchâtel, dut même donner une vigne à Jehan Prestre, son fils, afin que celui-ci pût offrir un gage à Regnaud Michet, bourgeois de Neuchâtel, qui lui avait versé d'avance les 9 florins pour lesquels il s'engageait à le servir pendant deux ans 96. D'ailleurs le serviteur n'était pas dépourvu de toute garantie non plus. Il avait la promesse écrite que son maître lui verserait à terme le salaire convenu. A défaut de payement, l'employé pouvait faire saisir et vendre les biens de son maître. Cela arriva à Nicolet Uldrissier qui n'ayant donné à son serviteur que trois florins, un chaperon, et d'autres menus objets, se vit saisir sa maison, rue des Escaffiers 97.
Il nous semble assez curieux de voir un fils de famille s'engager comme serviteur chez son père. Cela n'était pas impossible. En 1435, Vienet Laboriaul et sa femme entrèrent au service de Jean, leur père et beau-père, pour dix ans, au terme desquels Vienet devait recevoir 30 florins d'or et la quittance d'une dette de dix livres. Père et fils se promettaient d'ailleurs de se traiter comme il sied entre parents et enfants 98.
A côté des serviteurs il y avait évidemment aussi des servantes. Mais, chose étrange, les contrats d'engagement sont très rares. En
revanche, les servantes apparaissent assez fréquemment dans les donations testamentaires ou dans les legs entre vifs faits par les bourgeois, les curés, les chapelains ou les chanoines pour récompenser de " bons et agréables services ", de si bons et si agréables services même qu'il s'agissait souvent d'assurer l'avenir temporel de quelque descendant 99.
Lorsque les parents plaçaient leur fille comme servante chez d'autres bourgeois, ils tenaient à recevoir eux-mêmes le salaire convenu et, à défaut de payement, ils n'hésitaient pas à poursuivre leur débiteur. Conrad Maselier, en 1462, fit même vendre tous les biens de Guillemete, la clavenière, pour 18 livres faibles de Lausanne qu'elle lui devait pour le salaire de sa fille 100. Le salaire d'une jeune fille était de 30 sols faibles par an, en 1466, selon le contrat par lequel Jean Bovier loue sa fille à Pierre de Clérié 101.
Nous venons de passer en revue ce que nous révèlent les actes notariés de l'installation domestique de nos aïeux du XVe siècle, de leurs meubles, de leurs ustensiles, de leurs vêtements, puis des rares serviteurs ou servantes qui les aidaient et vivaient avec eux à la même table, du même pain et du même vin, dans ces demeures souvent exiguës, aux pièces rares, dont nous avons parlé dans un autre article 102.
Ces ménages nombreux, formés d'une ou de plusieurs familles apparentées ou associées, devaient accumuler de très abondantes provisions pour vivre des produits d'une récolte jusqu'à la moisson suivante. Ces provisions, ils devaient ensuite les gérer avec sagesse et ne les utiliser qu'à bon escient. En un mot ils devaient ménager, vocable qui alors avait encore tout son sens, car il s'agissait de prévoir intelligemment, d'organiser judicieusement et d'user à temps. Une ménagère était une organisatrice à longue échéance. Sans magasins pour se réapprovisionner, sans armoire frigorifique, sans congélateur, sans boîtes de conserves et même sans pommes de terre, elle devait nourrir chacun, et faire durer les vivres jusqu'à la nouvelle récolte. Ce n'est pas par hasard que les produits alimentaires s'appelaient alors des vivres. La ménagère, gérante de ces vivres, avait une situation indiscutée dans la famille, car elle avait la charge et la responsabilité de toutes les bouches de la maisonnée.
Elle devait conserver des denrées périssables, plus difficiles à garder que notre argent lui-même, prévoir toujours, avoir toujours.
La ménagère n'était pas devenue, comme aujourd'hui souvent, femme de peine ou de cuisine, les deux humbles labeurs que les moyens modernes lui ont laissés en la privant de sa plus noble tâche, celle de prévoir sans cesse, trois cent soixante-cinq jours d’avance, celle de
conserver et celle de gérer. Alors, la ménagère avait une fonction plus délicate que celle d'économe dans une institution. Ce que l'homme acquérait, ce que le sol livrait, la femme le conservait et, durant les douze mois, elle le répartissait, après l'avoir serré au fond de son cellier.
Elle doit bien prendre garde que rien ne s'y corrompe et que rien n'y moisisse. Plus que la cuisine c'est le cellier qu'elle gère et qui la préoccupe, car c'est là qu'est enfermée pour toute la " maisnie " la vie du lendemain. Aujourd'hui l'on construit sans cave et sans cellier. Les stocks impersonnels des entrepôts modernes en ont détruit l'utilité. Au XVe siècle chaque demeure était avant tout un toit, un foyer et un cellier. Chaque maison avait son cellier, dedans ou dehors, formant une construction spéciale, pleine des produits du sol pour toute une longue année: du vin tout d'abord, du rouge et du blanc, et parfois du rouge seulement, car c'était une nourriture. Un des conseillers de la ville, Nicolet Bergier, léguant à sa femme les denrées qu'elle a dû gérer durant sa vie, nous en donne la preuve. Il lègue: " Una bosseta de vin rouge tenant environ deux muyds (le muid valait 365 litres) estant, dit-il, en mon scelier, avec ung aultre bosset de vin rouge sur lequel nous buvons. " Il poursuit: " En oultre ly donne toute ma provision de froment et de cher sallée, excepté d'ung bacquon entier, lequel bacquon entier avec une bosse de quart muyds de vin qu'est encore oudit scellier, je donne et laisse a mes dessusdits heritiers pour leur aidier affere mes dessusdits bien faiz, payer mes dits debtes. " Huile, fruits et légumes, ayant une valeur moindre, ne sont pas mentionnés.
Dans ce testament Nicolet Bergier prévoit, conformément à la coutume, que sa femme pourra reprendre tout ce qu'elle a apporté. Et à cette occasion, il rend à celle qui a géré son ménage un témoignage de confiance d'une simplicité émouvante: " Je vuelz qu'elle soit crue par son simple serement en lieu de preuve " (1489) 103.
C'est la famille, non l'individu, qui à cette époque forme l'unité sociale. Le ménage, c'est-à-dire la demeure et l'ensemble des meubles est son centre. Mais le ménage, c'est aussi l'économie domestique basée d'une part, sur les immeubles, champs, prés, vignes et " cernils " appartenant à la famille entière, présente et future, et qui, pour cette raison, sont en général incessibles, et, d'autre part, sur les pâturages communs. Ces derniers, par concession perpétuelle, appartiennent au village ou à la ville qui, en fait, ne sont que des familles de familles. L'économie familiale s'épanouit dans une cellule bien vivante et autonome où règnent la raison et la confiance. Père, mère, enfants, serviteurs en font
page 81
partie, car tous se nourrissent à la même table du même pain et du même vin, conservé avec soin dans le même cellier dont la mère porte fièrement les clefs à sa ceinture.
F. LŒW.
ANNEXE
S'enssuit l'invantoire des bien meubles de Pierre Blomyse, marichalx, bourgois de Neuschastel et de sa femme, lesquel bien meubles sont estés mener a Crissié en la maison du curés dudit lieux, leur filz.
Premierement quatre pot d'estain
une XIIe d'escuelle d'estain
une chudière
sept pot de metalx, que petit que gros
cinq pelle pendant
deux comacle
deux andié
une pelle fryteure
une arce de fer
trois lit de plumme garny
vingt linceulx
cinq manti
cinq tualles
cinq arches de bois
quatre gielle a vin
une bosse tenant trois muids
trois basset
une cuve tenant cinq gielle
une vache et ung vealx
deux chaulit
une couchete
quatre achete
trois cro
ung fossieux
une piche
et ung pui
ung criblet
trois chandeler de loton et deux de fers et cinq bruyère
fait cedit envantoire le juedi apres le diemanche que l'on chante en notre mere saincte eglise letare, l'an notre Seigneur carrant mil CCCC LXX neuf, present Pierre' Berthod et Perrin Feche, tesmoings a ce apellés et requis.
Dans un autre article Regnald Collon, favre, confesse tenir de feu Pierre Blomyse : une enclume
deux soufflet
ung gros martelx
et ung curtilz gesant ou lieudit ou fornelx 104.
1 Cf. Musée neuchâtelois, 1961, p. 36-59.
2 H. Uldri, not., fol. 101, v°, par exemple.
3 Le cosandier était un tailleur ou un couturier.
4 Richard le Pic, not., vol. 1, fol. 63 : . Et aussi par tel condicion que ledit Hansoz et sa femme doivent demorer avec ledit Stener quatre an commençant le jour de la date de ceste, et a debout des quatre an, ledit Stene doit vestir et entroseler sa dite fille, selon sa puissance, comme fille de bourgeois ,> (1425).
5 Richard le Pic, not., vol. 1, fol. 23, V° (1424).
6 Ibidem, fol. 37, V° (1424).
7 Philippe Bugnot, not., fol. 236 (1484).
8 Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 118. Le gaudichon, selon Pierrehumbert est un jupon ou une jupe.
9 Ibidem, vol. 1, fol. 81.
10 Ibidem, vol. 4, fol. 227, V°.
11 Ibidem, vol. 4, fol. 120, V°: . Ung pot de metaul continant environ deux pot d'aigue . (1474). Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 189, V°: " Ung pot de metal tenans environ quatre pot ": " ung pot et ung demy pot d'estain. " Pierrehumbert dans son dictionnaire, p. 444, renvoie à Ramel, Système métrique.
12 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 146, V°. Un autre pot de métal fut vendu 15 sols à Yverdon en 1452. Ibidem, vol. 2, fol. 142, V°.
13 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 140, V°: "une chadiere a escofiez"; ibidem, vol. 2, fol. 69: "la grant chadiere"; Pierre Bergier, not. vol. 2, fol. 77; ibidem, vol. 4, fol. 378, V° : "une pele de covre".
14 Richard le Pic, not., vol. 2, fol. 69: " deux pelle de bassin.
15 Pour ce mot, voir aussi Richard le Pic, not., vol. 2, fol. 21.
16 Jacques de Grad, not.; vol. 2, fol. 79.
17 Gruyère, not., vol. 1, fol. 9, V°.
18 Philippe Bugnot, not., fol. 156.
19 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 145, Vo: " lectum pulmural cervical sive auriculare " ; Jacques de Grad, not., vol. 1, fol. 5, V°.
20 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 61.
21 Pierre de la Haye, fol. 157: " Item je donne a la dite Janne le scier du lit de ma chambre haulte sus le paille, ou le meilleur scier qui soit en ma maison. " (Testament de Nicolet Bergier, conseiller de Neuchâtel, 1489.)
22 Jacques de Grad, not., vol. 1, fol. 30.
23 Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 271.
24 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 19.
25 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 173.
26 Tuaille = toile.
27 Mémoires de l'Académie de Besançon, t. 9, p. 451.
28 Jacques de Grad, not., fol. 25; Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 106; ibidem, vol. 4,
fol. 293; Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 126.
29 Pierre Bergier, not., vol. 3, fol. 62, vo; ibidem, vol. 4, fol. 183, V°.
30 Pierre de la Haye, not., fol. 8.
31 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 61 : " Item une dozanne de lencioux, des melliourx, troy mantis, huit tergere, etc. " (1458). Selon Godefroy, tergeoir = serviette; tergeure, tergoure, terchure = essuie-mains, serviette, torchon, couverture. Ce dernier sens est exclu dans notre texte puisque les couvertures sont mentionnées sous la forme de culoetour.
32 H. Uldri, not., fol. 189, V°.
33 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 126: " ung puit, ung foussoir, etc. ". Pour le mot " pouer ", cf. Pierrehurnbert, p. 446. Pierre Bergiel, not., vol. 4, fol. 317, V°, cite aussi dans une énumération faite en 1464: . croc a terre et a femier, fossieux, pui, piches ".
34 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 140, V°.
35 H. Uldri, not., vol. 1, fol. 173-173, V°: "Aussy resservés que de six capes d'argent estant a l'ostelledit Henry en devrait havoir quatre et ladite Anthoinne deux ", (1447).
36 Pierre Bergier, not., vol. 3, fol. 62, V°.
37 Matile, "Musée historique, t. 3, p. 91.
38 Richard le Pic, not., vol. 2, fol. 56, V°.
39 Pierre Bergier, not., vol. 2, fol. 138. 1
40 H. Uldri, not., vol. 1, fol. 189, V°.
41 Ibidem, vol. 1, fol. 189, V°.
42 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 57: "Par tel condicion que ou cas que ledit Jehan Roselet me rendrait ung henez d'argent que je Ii ait presté, ou.a mes hoirs, je Ii promet de bailler, etc., quatre livres de Lausanne petite, etc. " (1463).
43 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 148, V° (1479).
44 Musée neuchâtelois, 1939, p. 105.
45 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 173.
46 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 145, V°; ibidem, vol. 1, fol. 81; MATILE, Musée historique, t. 3, p. 72.
47 Pierre Bergier, not., vol. 3, fol. 62, V°.
48 Guyot de Lannoix, not., fol. 17. Une blonque, donnée dans GAY, Glossaire archéologique du moyen âge et de la Renaissance, sous la forme de bloqueau, bloquel, bloque, était une boule de métal, une bille. Un mordant, en sellerie, est un clou à deux pointes qui se met sur le cuir des harnais ou des carrosses; c'est aussi un clou de métal, de,cuivre généralement, ici d'argent.
49 Pierre Bergier, not., vol. 3, fol. 63; ibidem, vol. 1, fol. 63; ibidem, vol. 4, fol. 145, V°; H. Uldri, not., vol. 1, fol. 53; Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 61.
50 Gruyère, not., fol. 175bis: " Confesse debvoir a Bendicte, sa femme, fille de Bendict Schaffer pour les mondres et joyaulx de son mariage, as savoir pour la corroye, dix libres et pour une paternostres soixante solz " (1496).
51 MATILE, Musée historique, t. 3, p. 72. Il c!te: Archives de l'Etat F 2, N° 45.
52 AMMANN, Mittelalterliche Wirtschatt im Alltag. Aarau, 1942-1954, p. 220.
53 Musée neuchâtelois, 1932, p. 7-16.
54 La cour comtale n'en était pas dépourvue. Marie de Chalon, par exemple, fit ,cadeau d'un saphir serti dans de l'or au chapitre de la collégiale, en 1468: " Une pierre precieuse, c'est assavoir ung saphir envesselé en or en manière d'une chastaingne. >, Gruyère, not., fol. 14.
55 AMMANN, op. cit., p. 179.
56 AMMANN, op. cit., p. 79; Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 183, vo; Musée 'neuchâtelois, 1932, p. 15.
57 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 215, vo.
58 Henri Pigaud, not., vol. 1, fol. 122.
59 Jacques de Grad, not., vol. 1, fol. 70: " 6 florins d'or et dix sols lausannois petite monnaie... " , " esquelx ledit Conrad, ad moy ledit Yaque estoy entenus tan pour achet de pater de coraul, pour saz feme, comme d'aultres danrées par moy ad luy vendues et deslivrées. >,
60 Musée neuchâtelois, 1921, article de A. PIAGET et L. MONTANDON: Un ortèure neuchâtelois. Cf. en outre Gruyère, not., fol. 67, V°; Pierre de la Haye, not., fol. 101, 102, 109, vo.
61 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 63; Jacques de Grad, not., vol. 1, fol. 5, vo.
62 Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 378, V°: " Item je donne et legue a la femme Jehan Gruère, mon filz, ma bonne robe de vairs ", "item je vielz et ordonne que mon petit tessus de vairs ferrer de cloz d'argent, que soit donné et delivré pour la fille dudit Jehan Gruyère ", (1482).
63 Ibidem, vol. 4, fol. 276. La guède donnait un beau bleu intense appelé " perse ". Cf. Iris ORIGO, Le marchand de Prato, p. 65.
64 Ibidem, vol. 4, fol. 378, V°. Testament de Catherine, veuve de Pièrre Gruyère, notaire: " Item encore donne et legue a ladite fille Jehan Gruère ung de mes couvrechief ", " item je donne et legue a la fille de Jehan Gaudet ung de mes aultres couvrechief ", " item je viulz et ordonne que quant Jehan Quemin se marieraz que on Iy donne ung de mes couvrechief ", (1482).
65 Pierre Bergier, not., vol. 2, fol. 36; ibidem, vol. 4, fol. 276, et 298, V°.
66 Pierre et Othenin Gruyère, not., vol. 1, fol. 5, V° (1453).
67 Borelier, not., fol. 9, V°: " Item je donne a messire Jehan de Marens... ma robe de voir et ung de mes chapiron de roge " ; item je donne a messire Pierre de Corcelle mon chapiron de pers. " Cf. aussi Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 106, V°. La robe que porte Henri Fabri sur la fresque malheureusement si pâle de la chapelle Saint-Léonard, dans la Collégiale de Nenchâtel, est verte..
68 AMMANN, op. cil., p. 83, 108, 225: unum par caligarum viridi coloris (1448). Cf. aussi Philippe Bugnot, not., fol. 99; Borelier, not., fol. 9, V°.
69 Par exemple Rogier VAN DER WEYDEN. La décollation de saint Jean-Baptiste, Musées de Berlin, reproduction dans Alt-NiederUindische Malerei, par Ernst HEIDRICH, planche 37.
70 Philippe Bugnot, not., fol. 99 " trois pourpoin de futainne " (1477). Borelier, not., fol. 18, V°: " ung gippon de fustainne " (1437). Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 119: " une chausse de blanchet et ung gipon de fustaing" (1473). Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 298, V°: " trois aulnes de gris et pour une gaudichon " (1464).
71 AMMANN, op. cil., p. 73: ex causa emptionis unius opellande seu caphardi (1400). Richard le Pie, not., vol. 3, fol. 52: " rendu a Gasper, pathour, ung mantel " (1463). Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 35: iresdecim magnas albos causa emptionis unius disploidis habiti (1457). AMMAm, op. cil., p. 225: Et inde obligai quandam vestem griseam unum pal' caligarum viridi coloris et un am disploidem tele (1423).
72 AMMANN, op. cit., p. 83 et 108.
73 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 77 : "Ledit Perrin doit soignier son dit ms de vesture, c'est assavoir de robes, de chemisse et de menuz draps " (1429). Une reproduction des vêtements de dessous se trouve dans l'excellent livre de Michèle BEAULIEU et Jeanne BAYLÉ, Le costume en Bourgogne de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire. Paris, 1956, planche XX.
74 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 71, V° (1465); Henri Pigaud, not., vol. 2, fol. 118, Vo (1431); ibidem, vol. 1, fol. 62 (1413); Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 65, Vo (1463) et vol. 4, fol. 245, Vo (1463) et 361, V° (1467).
75 Henri Pigatid, not., vol. 1, fol. 62, et vol. 2, fol. 126 ; Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 110.
76 Henri Pigaud, not., vol. 2, fol. 118, v°.
77 Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 361, v°.
78 Ibidem, vol. 1, fol. 65, v°.
79 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 71, V°.
80 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 119. Dambelin, Doubs, arr. Montbéliard, canton de Pont-de- Roide.
81 Henri Pigaud, not., vol. 1, fol. 62.
82 Ibidem, vol. 1, fol. 7.
83 Ibidem, vol. 1, fol. 15, "unum trairoz, ".
84 Richard le Pic, not., vol. 1, fol. 45.
85 Ibidem, vol. 1, fol. 3 et 5.
86 Richard le pfc, not., vol. 3, fol. 103, v°.
87 Henri Pigaud, not., vol. 2, fol. 126.
88 Ibidem, vol. 1, fol. 69, va.
89 Pierre Bergier, not., vol. 1, fol. 67, et vol. 4, fol. 245, v°.
90 Ibidem, vol. 4, fol. 169, va, et vol. 1, fol; 110, " et pour sa fornemente une paire de chausse de sergy, ung gart de corps de sergy, et deux chemises et de sulier ce qu'illy en faul draz, et ùng chapel jusques à quatre solz ".
91 Henri Pigaud, not., vol. 2, fol. 118, v°.
92 Richard le Pic, not., vol. 1, fol. 45.
93 Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 361, V°.
94 Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 71, v°.
95 Henri Pigaud, not., vol. 1, fol. 62.
96 Ibidem, vol. 1, fol. 77, Vo (1414).
97 Jacques de Grad, not., vol. 1, fol. 210: (' un chappiron et aultres menus aglons ".
98 H. Uldri, not., fol. 17, v°.
99 Jacques de Grad, not., vol. 2, fol. 89bis; Richard le Pic, not., vol. 3, fol. 93; Henri Pigaud, not., vol. 1, fol. 31, 45, va, 146, 164; Pierre Bergier, not., vol. 4, fol. 11, va, et fol. 69, par exemple.
100 Richard le Pic, not., .vol. 3,. fol. 39, va: "tant pour les loier de ma fille comme pour autre chose. )\
101 Philippe Bugnot, not., fol. 33.
102 Musée neuchâtelois, 1960, p. 82 et suiv.
103 Pierre de la Haye, not., fol. 157.
104 P. Bugnot, not., fol. 156.